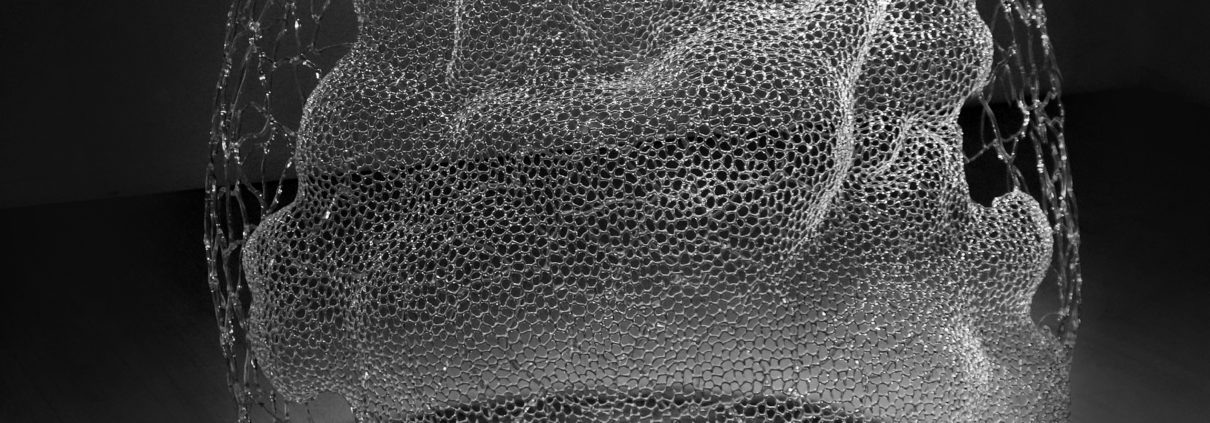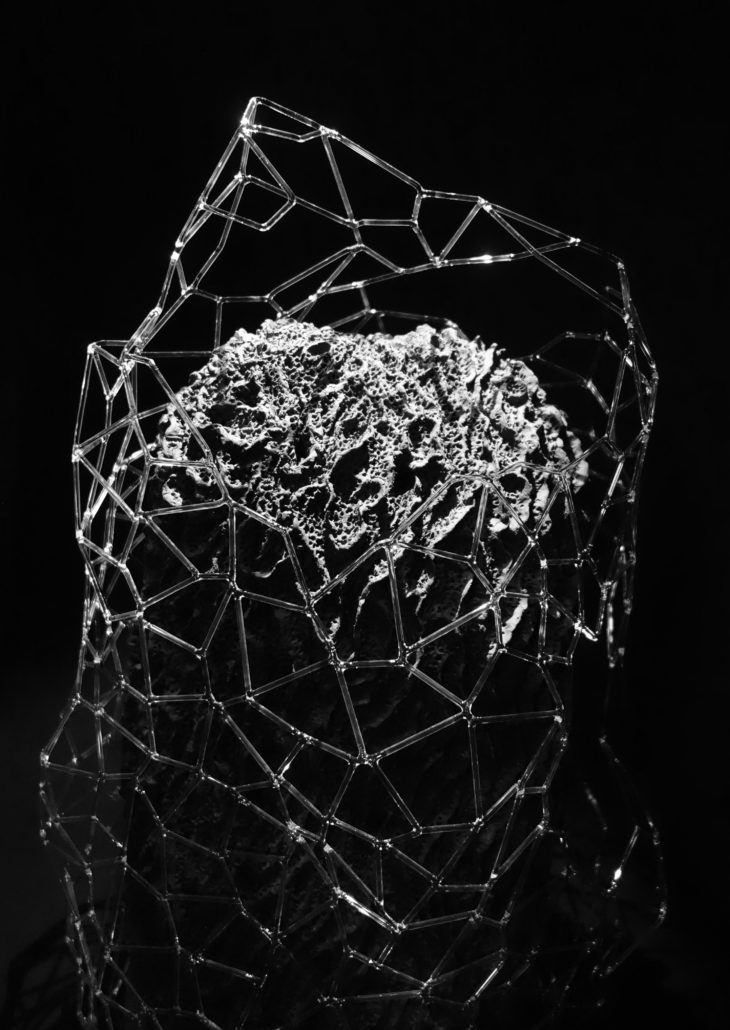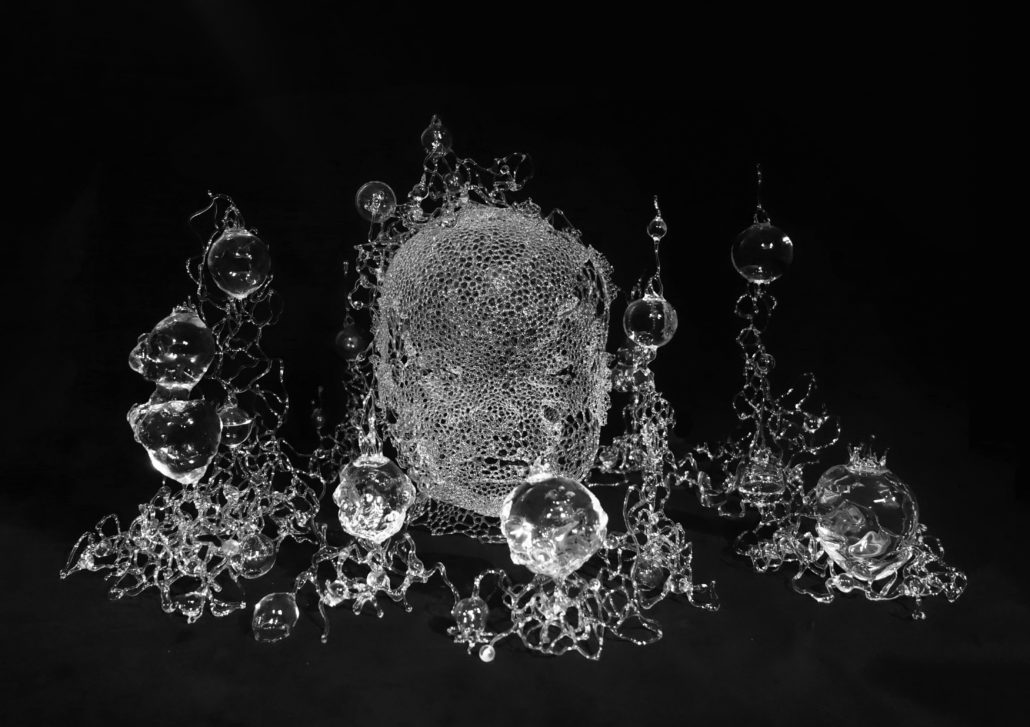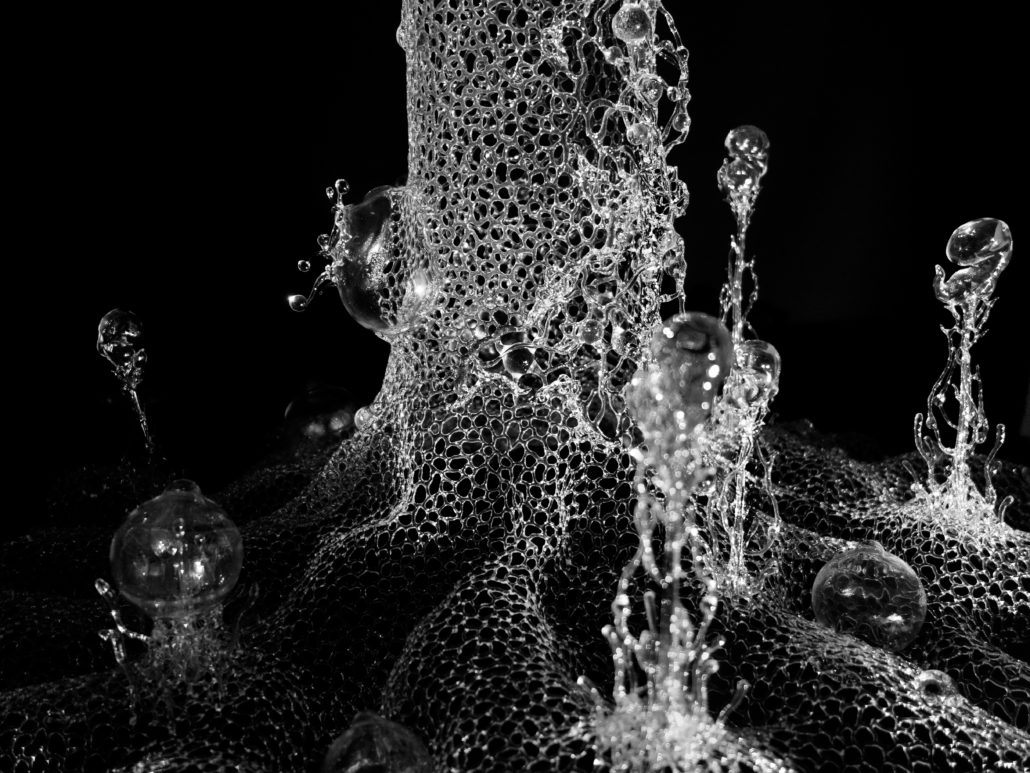Le Dessin à Bologne
Carrache, Le Guerchin, Dominiquin …

C’est la Bologne maniériste et berceau du baroque, ville des grands décors dans les églises et les palais, que le Cabinet des dessins Jean Bonna met à l’honneur. Une trentaine de dessins issus de la collection des Beaux-Arts de Paris, pour certains inédits, permet d’apprécier la richesse d’invention des maîtres de la cité émilienne. Rassemblant des études de composition ou de figures destinées tant à des tableaux qu’à des grands décors, l’ensemble se propose d’illustrer la variété des genres abordés par les artistes bolonais des XVIe et XVIIe siècles, des maniéristes Biagio Pupini ou Bartolomeo Passerotti jusqu’aux peintres baroques les plus célèbres.

Bologne est le lieu dès le XVIe siècle de prestigieux cycles de fresques grâce notamment aux Carrache. Domenico Maria Canuti poursuit cette tradition avec de nombreux plafonds, dont le somptueux projet pour une Apothéose de Romulus, récemment acquis par les Beaux-Arts de Paris, offre un bel exemple. L’exposition présentera notamment des dessins des Carrache, du Guerchin, de Simone Cantarini et Elisabetta Sirani, du fresquiste Domenico Maria Canutti comme du caricaturiste Giovanni Antonio Burrini.

Dans cette nouvelle exposition, plusieurs feuilles des Carrache, montrées pour la première fois au public, mettent en valeur leurs inventions tant dans le genre du paysage que du grand décor. Un ensemble exceptionnel d’oeuvres du Guerchin (1591-1646), le plus admiré et le plus talentueux des suiveurs des Carrache, dévoile sa virtuosité dans la représentation du corps humain et du paysage, genres qu’il aborde dans des techniques aussi variées que la plume, l’encre brune ou le lavis brun. À ses côtés, on découvre les feuilles de Simone Cantarini (1612/14-1648), spécialisé dans les scènes religieuses pleines d’élégance, mais également de la célèbre peintre bolonaise Elisabetta Sirani (1638-1665). Réputée pour sa vertu et son érudition, elle occupe à Bologne une place de premier ordre, ouvrant un atelier pour former des femmes peintres.

Enfin il ne faut pas oublier que Bologne est à l’origine de l’invention de la caricature, tradition mise en oeuvre par les Carrache et poursuivie par de nombreux élèves, dont Giovanni Antonio Burrini (1656-1727) : son portrait charge en est un témoignage saisissant.